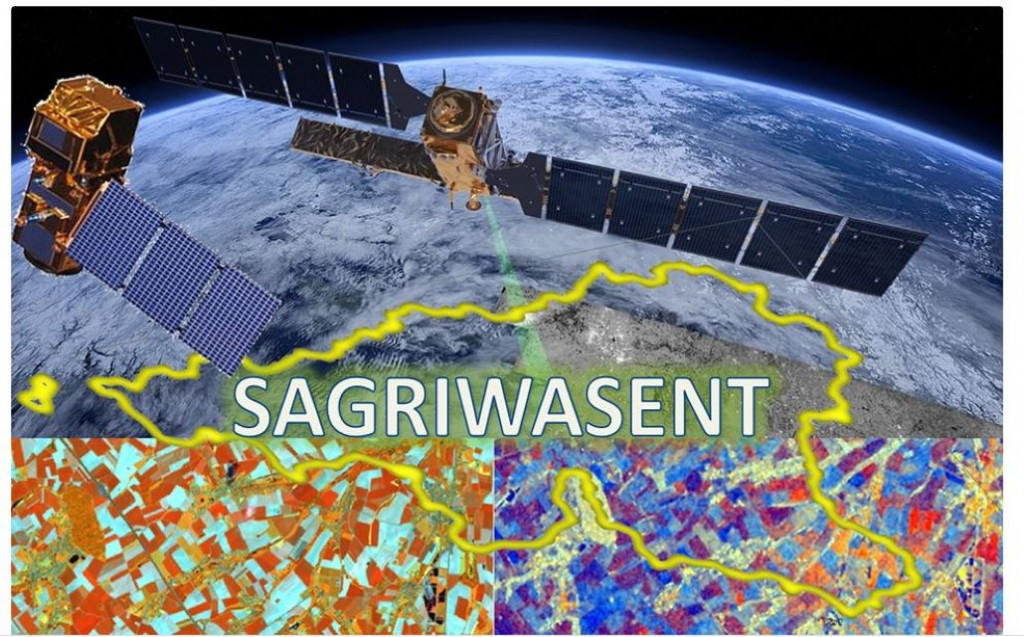1. Historique
L’histoire a débuté il y a plus d’un siècle.
" En juin 1913, le Département de l’Agriculture créa, à l’Institut agronomique de l’Etat, à Gembloux, la Station Officielle de Recherches pour l’Amélioration des Plantes.
La mission bien définie, de la nouvelle institution était :
- de créer des variétés améliorées, spécialement adaptées aux perses régions agricoles belges ;
- d’entreprendre, éventuellement, des recherches scientifiques dans le domaine de la Génétique, surtout dans ses applications à l’amélioration des plantes. »
Ainsi s’exprimait le premier Directeur de la station en 1927. A l’exception des dénominations qui ont évolué avec le temps, les principales missions de ce que l’on appelle désormais le pôle Sélection céréalière sont toujours restées identiques à celle décrites plus avant par Messieurs Journée, Lathouwers et Larose, les 3 premiers sélectionneurs Gembloutois.
Si à l’heure actuelle, on devait préciser cette mission, on pourrait écrire que notre objectif est : « de maintenir et de créer une persité des ressources phytogénétiques la plus riche possible pour pouvoir aujourd’hui, dans dix ans ou dans un siècle y puiser les caractères phénotypiques qui agencés de façon harmonieuse nous permettent dès à présent, de proposer aux agriculteurs de nouvelles variétés particulièrement adaptées aux fluctuations de l’environnement tout en répondant aux attentes de la société »
Depuis plus d’un siècle, la céréale est un des fleurons de la Wallonie et du Centre de Recherches agronomiques. Durant des décennies, le Centre de Recherche, alors appelé Institut, a fourni au monde agricole belge des variétés de froment, d’épeautre, d’orge et d’avoine. En un peu plus d’un siècle, c’est plus de 140 variétés de 10 cultures différentes que le CRA-W a proposées aux agriculteurs (Figure 1). Jusqu’à la fin des années soixante (septante) les variétés issues de la sélection publique occupaient les premières places du marché national. Après les années septante, les compagnies privées ont pris le relais et ont développé de nombreuses variétés qui ont pleinement satisfait les agriculteurs. Les activités de sélection de la Station d’amélioration se sont progressivement réduites.

Fig 1 : Tableau reprenant les variétés créées par la Station d’amélioration des plantes de Gembloux (pour agrandir télécharger ce fichier)
Plus proches de nous, au début des années 2010, les dernières maisons de sélection belges ont à leur tour cessé leur activité de sélection. Les dernières variétés belges de froment (Childéric, Jorion sa ; Alcides, Clovis Matton-Limagrain) ont désormais plus de dix ans et ne se retrouvent plus sur le marché.
Au CRA-W, la sélection s’est maintenue en épeautre avec, en moyenne, la mise sur le marché d’une variété tous les 3-4 ans. Aujourd’hui, l’héritage de la Station d’Amélioration est double :
D’une part, le CRA-W dispose d’importantes collections de variétés anciennes et modernes pour les espèces froment et épeautre (Figure 2).
Le maintien de ces collections est la garantie de la préservation de la persité mais aussi, de notre terroir.
D’autre part, la création variétale est avant tout un savoir-faire. Conduire des cultures et a fortiori des essais ne s’improvise pas. Croiser et sélectionner des phénotypes d’intérêt, est un métier. Au fil des générations, sélectionneurs et chercheurs ont évolué, le matériel et les techniques culturales également mais tout comme il y a cent ans, les qualités d’observation des plantes et de perception du milieu restent les meilleurs garants de la qualité de notre travail.

Figure 2 : La conservation et la valorisation des collections d’anciennes variétés est à la fois une mission et un des atouts du CRA-W.
À la suite de l’arrêt des activités des entreprises privées locales et à la disparition progressive de variétés belges, un programme de sélection du froment a été relancé au CRA-W en 2019. Deux années plus tard, en 2021, c’est l’évolution de notre climat qui a motivé le démarrage du programme de sélection « Blé dur ».
Le CRA-W conduit donc de front, trois programmes d’amélioration de céréales : l’épeautre, le froment et le blé dur. Les techniques de création variétale n'ont pas fondamentalement changé depuis le 20ème siècle et pourraient se résumer ainsi:
- Identifier et connaître des variétés-parents susceptibles d’engendrer des lignées intéressantes.
- Réaliser des croisements (castration + pollinisation) et créer ainsi une persité dans laquelle certains descendants surpasseront leurs parents (disjonction transgressive). Ces opérations se font encore et toujours avec des pinces à épillet et des ciseaux à ongles.
- Semer les grains obtenus et sélectionner les plantes présentant les caractères les plus intéressants.
- Faire évoluer la descendance vers des lignées stables qui maintiennent les caractères désirés. Une petite dizaine de générations sont nécessaires pour obtenir une variété fixée.

Figure 3 : Les croisements constituent la base de la sélection. Ils se décomposent en deux étapes : la castration et la pollinisation.
Parallèlement à ces opérations, à partir de la cinquième génération (F5), les lignées sont mises en essais dans un maximum de situations afin de pouvoir les caractériser au mieux. Des essais spécifiques sont également réalisés pour confronter les lignées à des maladies ou à des insectes qui ne s’observent pas systématiquement dans les essais classiques.
A partir de la septième génération (F7), il devient impératif de multiplier les lignées et d’en accroître la quantité de semences pour d’une part pouvoir satisfaire à toutes les demandes de semences pour les essais officiels et privés et d’autre part pour générer les semences de « pré-base » qui permettront aux semenciers de débuter la production des semences commerciales.
2. Programmes de sélection
Les 3 programmes de sélection se distinguent par leurs objectifs, par leur ampleur ainsi que par leur état d’avancement.
2.1 Epeautre
2.1.1 Historique
La Sélection de l’épeautre à Gembloux est réalisée sans interruption depuis la fin de la première guerre mondiale. Dans un premier temps, les sélectionneurs ont collecté les races locales cultivées en Wallonie (1919), les ont mises en culture, les ont comparées, et en ont isolé les plus performantes. Parmi elles, la lignée 24 a connu un large succès durant des décennies et elle est même encore cultivée sur quelques hectares aujourd’hui. A partir des années 50, des croisements ont été réalisés et ont progressivement donné naissance à quelques variétés bien connues des agriculteurs telles que Rouquin (1979), Hercule (1982), Franckenkorn (1995), Cosmos (2000), Sérénité (2015) ou plus récemment la variété Lucky (2021).
2.1.2 Objectifs
L’objectif actuel du programme épeautre est de mettre sur le marché des nouvelles variétés à profils agronomiques et technologiques variés. Par exemple, des variétés ayant la productivité et la qualité de Cosmos mais sans sa sensibilité à la rouille jaune, des variétés panifiables telles que Sérénité mais dont la résistance au froid permettrait sa culture en Ardenne ou encore des variétés plus précoces afin d’éviter les pertes de productivité dues aux sécheresses de plus en plus fréquentes, particulièrement en sol filtrant comme c’est le cas en Famenne. L’accent de la sélection épeautre est principalement mis sur l’aspect rustique de cette culture. Aucune variété nouvellement inscrite ne doit nécessiter plus d’un traitement fongicide ni plus d’un traitement raccourcisseur. Des variétés spécifiques à la conduite en agriculture biologique arrivent au terme du processus de sélection et pourront prochainement être commercialisées.
2.1.3 Ampleur du programme
Une cinquantaine de croisements sont réalisés chaque année et 1500 lignées d’épeautre (F3-F8) sont annuellement évaluées dont 250 sur les 3 sites d’essais (Hesbaye, Condroz, Ardenne (figure 4)). Un quatrième essai est réalisé selon le cahier des charges Agriculture biologique. Il permet d’évaluer les lignées les plus adaptées à ce type de conduite. D’autres essais spécifiques permettant de tester les résistances (cécidomyie, carie, rouille noire, …) sont régulièrement mis en place.

Figure 4 : Les essais extérieurs comme celui de Warempage (Ardenne) sont fondamentaux pour caractériser les variétés et sélectionner des variétés adaptées à chaque région.
2.2 Froment d’hiver
2.2.1 Historique
La sélection du froment a connu une époque faste entre 1930 et 1980. Des variétés telles que Précoce de Gembloux (1930), Hybride du Jubilé (1937), Directeur Journée (1949), Jufy (1954), Professeur Marchal (1956), Cama (1966) et Zémon (1977) ont toutes connu un développement important et subsistent dans la mémoire des anciens. Depuis 2019, les croisements ont repris et nous espérons proposer de nouvelles variétés dans les années à venir.
2.2.2 Objectifs
Le CRA-W n’a pas pour mission de concurrencer les grandes maisons de sélection privées. La disparition des derniers sélectionneurs privés belges, nous a, en revanche, motivé à reprendre le travail par crainte d’une disparition de variétés-lignées adaptées au pays. Les objectifs du programme froment sont de créer des variétés adaptées aux conduites faibles intrants (dont l’agriculture biologique), aux associations culturales (Pois-froment), à certaines mesures agro-environnementales (protection des oiseaux). De la recherche fondamentale est également entreprise afin de fournir aux sélectionneurs étrangers des outils d’amélioration (pré-breeding). C’est notamment le cas pour la recherche de résistance aux insectes.
2.2.3 Ampleur du programme
Le programme froment est le plus petit de nos 3 programmes. Une trentaine de croisements sont réalisés chaque année et 300 lignées sont actuellement étudiées. De nombreux échanges avec les stations INRAE de Renne et d’Estrée-Mons ainsi qu’avec l’Agroscope (Genève), nous permettent de combler plus rapidement notre retard. Les premières variétés pourraient être inscrites en 2028.

Figure 5 : La recherche de résistance aux insectes comme ici face aux cécidomyies est l’une des spécialités du CRA-W
2.3 Blé dur
2.3.1 Historique et objectifs
A l’automne 2018, après deux années de sécheresse, un premier essai comparant une dizaine de variétés de blé dur a été semé. La culture était alors inconnue en Belgique et au grand étonnement d’une majorité de sceptiques, en juillet 2019 nous avons obtenu des rendements de 9 tonnes/ ha et une qualité tout à fait acceptable. L’année suivante, avec une fumure plus adaptée, nous avons réitéré l’expérience avec le même succès au niveau du rendement mais avec de surcroît une qualité digne des meilleures régions d’Italie. En 2021, ce fut une autre histoire : froid hivernal, verse, maladies, pluies à la récolte entraînant une pauvre qualité, rien n’a été épargné à la culture. Deux solutions : abandonner la culture ou tenter de l’adapter à nos conditions. Nous avons opté pour la seconde et le programme blé dur a vu le jour. Les objectifs sont évidents : obtenir des variétés résistantes au froid, aux maladies océaniques, aux cécidomyies et conservant une bonne qualité (vitrosité) même lors d’été pluvieux.
2.3.2 Ampleur du programme
Comme pour l’épeautre, une cinquantaine de croisements ont été réalisés chaque année depuis 2021. Plus de 800 lignées sont actuellement évaluées. Une étroite collaboration s’est progressivement établie avec nos collègues allemands de l’Université d’Hohenheim qui poursuivent les mêmes objectifs ce qui permet à nos deux institutions de quasiment doubler nos capacités. Nous espérons être en mesure de proposer les premières variétés de blé dur belges en 2030.

Figure 6 : La création de variétés implique une bonne connaissance du comportement des variétés-parents d’où la nécessité de nombreux essais dans des conditions variées.
3. Activités de recherches
La sélection est une discipline centrale qui interagit avec chaque domaine de l’Agronomie : Phytopathologie, Entomologie, Phytotechnie, Technologie alimentaire… Cet aspect généraliste nous permet de contribuer, à notre niveau, à de nombreux projets collaboratifs. Les projets en cours et en construction concernent la cécidomyie jaune du blé, la cécidomyie orange du blé dur, la rouille noire de l’épeautre, la vitrosité du blé dur, la prévention des risques de propagation des virus des céréales, les mélanges intra et inter-spécifiques, la dynamique de tallage des céréales, la problématique de la stérilité des épis,…
4. Activités de services
Créer des variétés sans les commercialiser n’a pas de sens, vendre des semences sans accompagner les producteurs n’en a pas plus. Afin de permettre aux agriculteurs de tirer le meilleur parti de chacune des variétés, nous publions de manière hebdomadaire des avis sur l’état de la culture d’épeautre et sur les pratiques les plus adaptées à chaque situation. Ces bulletins d’information sont relayés par le CePiCop et de temps à autre, par la presse agricole.
L’étude des variétés nous amène à faire de nombreuses observations que nous mettons à profit pour créer ou renforcer des OAD (Outils d’Aide à la Décision), tous disponibles sur le site Agromet. Il s’agit notamment de Ceciblé, Phénoblé, Fongiblé ou d’autres OAD en cours d’élaboration.
Que ce soit pour présenter l’état d’avancement de la sélection ou pour exposer des thématiques plus globales telles que le dérèglement climatique ou l’histoire des céréales, nous organisons ou répondons à de nombreuses sollicitations pour des conférences tant en Belgique qu’à l’étranger.
5. Mémoires, Stages et Etudiants-Jobistes
Conscients de notre rôle dans la transmission d’un savoir-faire mais également dans l’espoir de susciter des vocations, nous encadrons chaque année des mémoires d’étudiants issus des universités et hautes-écoles belges et étrangères. Ces étudiants sont une plus-value pour nous car ils nous permettent d’approfondir les thématiques de recherche que nous développons. Durant la haute saison, entre juillet et septembre, nous engageons également une douzaine d’étudiants jobistes pour nous permettre de récolter puis de préparer les semis des milliers de parcelles qui sont nécessaires à la Sélection.