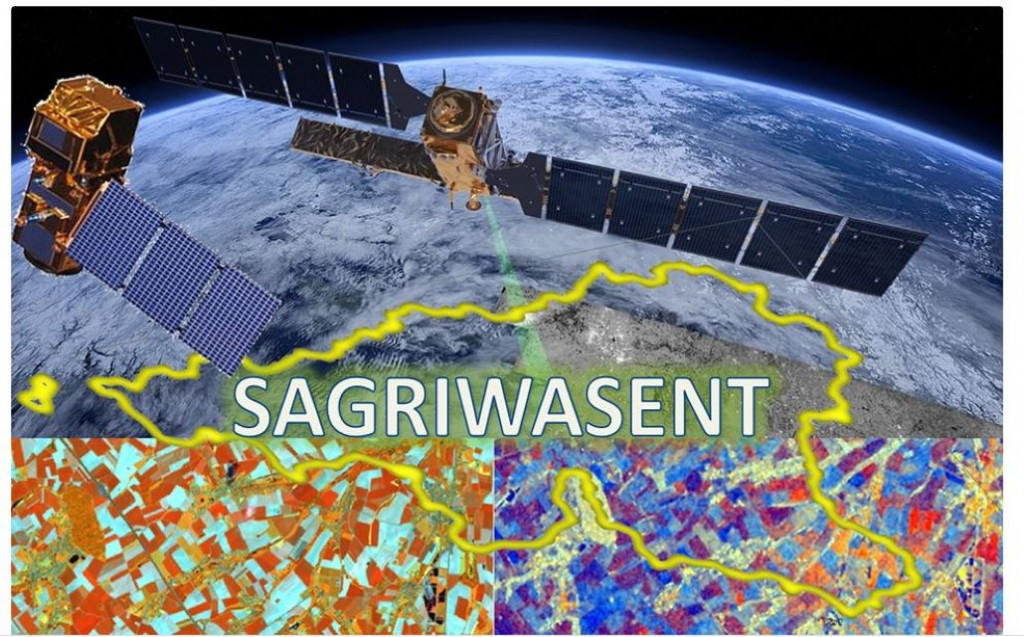Introduction
Le développement conséquent des céréales alimentaires en Wallonie est essentiel pour le maintien et la diversification économique de ce secteur. Le chiffre d’affaires du secteur de production primaire agronomique wallon est de 1,9 milliard € dont 21% (405 millions €) viennent de la production des céréales et génèrent 22 000 emplois directs. La principale céréale produite sur notre territoire est le froment. Les variétés de froment cultivées en Wallonie sont rarement adaptées à une valorisation alimentaire humaine. Il en résulte que la production de froment wallon est destinée à 46% pour les animaux et à 44% pour la transformation en bioéthanol de première génération. Cette dernière est vouée à disparaitre vu les objectifs européens en termes de réduction de gaz à effets de serre de 55% d’ici 2030 et neutre d’ici 2050 ainsi que l’interdiction des voitures thermiques d’ici 2035 et du bioéthanol en provenance du MERCOSUR. La relocalisation de la production de céréales alimentaires en Wallonie est essentielle pour se substituer graduellement à celle destinée à l’amidonnerie-éthanolerie. Cela permettra aussi d’apporter la résilience à nos transformateurs alimentaires dont un approvisionnement local est nécessaire vu les crises mondiales successives. L’industrie alimentaire en Wallonie représente 10,5 milliards € de chiffre d’affaires, 25 000 emplois directs et 6 milliards € d’exportation.
Moins de 10% de lots de froment wallons sont utilisés par nos transformateurs alimentaires. Les variétés de froment cultivées en Wallonie sont choisies avant tout au regard de leur rendement en grains, au détriment des variétés adaptées à la meunerie et aux transformateurs locaux. Ces acteurs ont besoin de variétés adaptées avec des protéines de qualité panifiable et des teneurs en protéines acceptables. Le froment n’est pas une commodité. Il y a des variétés avec des qualités technologiques très différentes destinées à des usages diamétralement opposés. Il n’existe pas de bons grains de qualité technologique standard, tout est relatif. La qualité sanitaire pour les contaminants comme les mycotoxines, elle est définie par la loi. La présence de contaminants et d’impuretés devient un point d’attention de plus en plus critique vu la diminution d’utilisation d’intrants pour répondre à la demande sociétale de produire plus durablement.
Objectifs
Pour développer l’utilisation des céréales wallonnes en alimentation humaine, il faut faire correspondre la qualité technologique et sanitaire des lots de céréales aux attentes des transformateurs locaux et en permettre la culture de manière plus durable. Le projet ValCerWal a développé des solutions pour gérer cette problématique afin de permettre le maintien et l’essor tant de la production que de la transformation des céréales alimentaires en Wallonie. Il s’est focalisé principalement sur la qualité technologique et sanitaire du froment panifiable. Il a également traité de ces qualités pour l’épeautre, l’orge brassicole et le blé dur.

Ce projet a développé 3 approches pour limiter les problèmes technologiques et sanitaires des céréales wallonnes afin d’éviter l’impact économique lié au déclassement des lots :
- Optimiser les outils de tri des grains à la valorisation recherchée
- Recherches en termes de qualité technologique pour conseiller les agriculteurs et les transformateurs au niveau du choix variétal et de la recommandation de fumure azotée pour des utilisations en alimentation humaine
- Classer et évaluer plus efficacement l’aptitude à la transformation
Application : Optimiser les outils de tri des grains à la valorisation
Le tri est un levier post-récolte nécessaire pour amener un lot de grains aux objectifs de qualité (normes ou engagement contractuel) visés. Les systèmes de tri se redéployent pour pallier aux problématiques de lutte contre les adventices et les maladies des grains. En agriculture à faible intrant et biologique, les leviers sont limités pour la gestion de ces problématiques. Le tri est incontournable pour améliorer la qualité technologique et sanitaire afin d’éviter l’impact économique du déclassement d’un lot à cause d’une petite fraction fortement déviante.
Le trieur parfait n’existe pas. Il faut donc choisir une combinaison de trieurs et de réglages en fonction des défauts rencontrés dans le lot et de la qualité envisagée. Le tri est appliqué pour atteindre différents objectifs de qualité qui sont : Qualité sanitaire, Production de semences, Séparer des cultures associées et Améliorer la qualité technologique. La plateforme de trieurs à l’échelle de plusieurs kg de grains mise en place est constituée des équipements suivants :

Cette plateforme de trieurs nous a permis d’étudier leur impact sur la qualité technologique et sanitaire du froment ainsi que de répondre à des problématiques spécifiques d’agriculteurs.
Les trieurs physiques sur base de la largeur du grain (nettoyeur-séparateur) et de la longueur du grain (trieur alvéolaire) permettent de retirer une grande partie des impuretés ainsi que d’améliorer la taille du grain (poids de mille grains et poids à l’hectolitre) et de légèrement améliorer la qualité de l’amidon.
Le trieur physique sur base de densité (table densimétrique) permet de retirer des impuretés et des grains contaminés de même largeur et longueur que les grains d’intérêts ayant une densité différente. Cette fraction d’impuretés et de grains contaminés est souvent faible et engendre une perte conséquente de bons grains dans les fractions de refus. Au niveau technologique, elle permet d’améliorer le temps de chute de Hagberg (prégermination physiologique).
En plus de retirer efficacement et rapidement une partie conséquente des impuretés, le pré-nettoyeur aérodynamique permet de fortement améliorer la taille des grains d’un lot en retirant les plus petits, ainsi que d’apporter une légère amélioration du temps de chute de Hagberg et de l’indice de sédimentation Zélény pour des lots présentant des valeurs médiocres pour ces 2 paramètres.
Le trieur optique proche infrarouge au grain à grain sépare sur base de critères qualités spécifiques souvent invisibles. Il permet de retirer de manière spécifique les impuretés ainsi que les contaminants présents en teneur élevées. Au niveau technologique, il est le seul trieur en mesure de séparer les grains sur base d’un paramètre chimique comme la teneur en protéines. Nous avons montré que ce tri basé sur la teneur en protéines est un levier post-récolte permettant d’améliorer la capacité de panification du froment. L’extraction de la fraction de grains à teneur en protéines plus élevée permet d’améliorer la fonctionnalité de la farine (augmentation de la teneur en gluten, stabilité de la pâte, affaiblissement des protéines et force boulangère).
L’analyse économique sur le tri du froment a montré que le tri peut être rentable à l’échelle individuelle (ferme, coopérative, organisme stockeur) et contribuer significativement à l’augmentation de la part de céréales panifiables à l’échelle de la filière.
Application : Recherches en termes de qualité technologique pour conseiller les agriculteurs et les transformateurs au niveau du choix variétal et de la recommandation de fumure azotée
Pour faire correspondre les variétés et la fumure azotée de froment, d’épeautre, d’orge brassicole et de blé dur aux besoins de nos transformateurs, il est nécessaire d’évaluer la qualité technologique des variétés de manière approfondie à l’aide d’essais variétaux existants en Wallonie. Au niveau agronomique, il est essentiel que les variétés soient adaptées à notre pédoclimat ainsi qu’à une conduite culturale avec moins d’intrants. Pour se faire, l’évaluation technologique élaborée a également été appliquée au réseau variétal du Plan BIO2030 pour identifier des variétés robustes tant au niveau agronomique que technologique.
Notre méthodologie d’analyse technologique s’est focalisée sur la qualité des constituants chimiques (protéines et amidon) notamment en recherchant, pour le froment, l’épeautre et le blé dur, une protéine de qualité panifiable élevée plutôt que d’en viser une quantité importante de faible qualité panifiable. Pour se faire, nous nous sommes basés sur l’analyse à l’alvéographe et au Mixolab+ sur la farine blanche issue des grains.

L’évaluation technologique approfondie appliquée aux différents essais variétaux a permis d’identifier des variétés pertinentes de haute qualité panifiable pour le froment et l’épeautre, brassicole pour l’orge et pastière pour le blé dur ainsi que leur profil global de qualité technologique lorsqu’elles sont cultivées en Wallonie. Le choix de la variété détermine majoritairement la qualité technologique. Pour le froment, l’épeautre et le blé dur, les caractéristiques technologiques les plus robustes à l’effet de l’année, et donc celles qui sont le plus définies par la variété, sont la force du gluten et sa nature suivie par la nature de l’amidon et ses propriétés rhéologiques.
La quantité et le fractionnement de la fumure azotée est optimisée en Wallonie au regard uniquement du rendement en grains. Une analyse approfondie de la qualité technologique a été réalisée pour les essais en fumure azotée existants pour des variétés de froment panifiable afin d’optimiser la fumure azotée et son fractionnement par rapport à la qualité panifiable de la protéine. Une fumure azotée de 220uN en 4 fractions (tallage 40uN + redressement 80uN + 2ième nœuds 40uN + dernière feuille 60uN) est recommandée pour obtenir les forces de gluten les plus élevées. La fraction 2ième nœuds est à adapter en fonction de son objectif de fumure azotée totale sans perdre trop de qualité panifiable. L’augmentation de la fumure azotée accroit surtout la teneur en protéines et l’extensibilité du gluten ainsi que la force du gluten. Certaines variétés plafonnent en force de gluten au-delà d’une fumure azotée de 180uN.
Application : Classer et évaluer plus efficacement l’aptitude à la transformation
Le choix de la variété est déterminant pour l’aptitude à la transformation d’un lot. Les analyses technologiques des différents essais variétaux ont permis d’établir des classements regroupant les variétés par catégories de qualité technologique (panifiable pour le froment et l’épeautre, brassicole pour l’orge et pastière pour le blé dur) distincte spécifiques à notre pédoclimat et nos transformateurs en fonction du mode de production (conventionnel et biologique). C’est un point critique car la qualité technologique d’une variété est spécifique au pédoclimat d’une région donnée et du mode de production ainsi que des attentes en termes de qualité des transformateurs locaux.


Des méthodes rhéologiques alternatives (GlutoPeak et variantes de l’alvéographe et Mixolab) ont été mises au point et/ou appliquées pour permettre une évaluation plus spécifique et rapide de la qualité technologique d’un lot. Elles offrent une meilleure discrimination variétale et constituent un complément efficace aux méthodes classiques, particulièrement utiles dans un contexte de screening de lots industriels et de sélection variétale.
La qualité du gluten est essentielle pour déterminer l’aptitude à la panification d’une variété ou lot de froment et d’épeautre. Les méthodes rhéologiques nécessitent une quantité conséquente de temps, de main d’œuvre et de quantité d’échantillon. Nous avons exploré la chromatographie comme alternative plus efficiente pour le froment.
Une méthode d’extraction et analyse par chromatographie basé sur l’exclusion de taille a été développée. Elle permet d’obtenir 6 fractions : F1-gluténines de haut poids moléculaire, F2-gluténines de bas poids moléculaire, F3-ω-gliadines, F4-α, β et γ-gliadines, F5-globulines et albumines et F6-petites protéines solubles. Cette méthode a permis de distinguer les variétés par leur profil protéique. Des matrices de corrélation ont été établies entre les fractions protéiques et les paramètres technologiques, pour trois types de mouture : farine blanche, mouture intégrale et mouture intégrale tamisée. Peu de corrélations significatives ont été observées, quel que soit le type de mouture.
Une méthode d’extraction et analyse par chromatographie basée sur la phase inverse a été développée.
Elle permet une séparation très fine des 3 extraits protéiques : 1-Albumines et globulines, 2-Gliadines et 3- Gluténines. Les chromatogrammes ont nécessité des prétraitements de données élaborés pour les comparer aux données technologiques. Elle n’a pas permis de distinguer les échantillons en fonction de leur qualité technologique.
Le changement climatique et l’augmentation des pratiques phytotechniques moins intensives favoriseront le développement d’une flore fongique produisant des mycotoxines dans les céréales de notre région. Il s’agit d’un point de vigilance accru tant sur la quantité que sur la nature des mycotoxines présentes. Les plus critiques en céréales au champ sont les mycotoxines venant des agents de la fusariose des épis et ceux de l’ergot. Nous avons développé et validé une méthode robuste d’analyse multi-mycotoxines des Fusarium par UPLC-MS/MS. Elle a été appliquée sur plusieurs variétés et lieux en 2023 et 2024 pour évaluer la présence en froment de ces mycotoxines en Wallonie. Les mycotoxines détectées ont été le DON, la ZEA, l’ENN A1, l’ENN B et l’ENN B1. L’ENN B a été la mycotoxine la plus fréquemment détectée. Cette méthode d’analyse a été appliquée à une expérience de tri pour 3 niveaux différents de mycotoxines DON et OTA sur des échantillons distincts. La capacité à éliminer les grains les plus contaminés a été évaluée sur 3 systèmes de tri : nettoyeur-séparateur, table densimétrique et trieur visible-infrarouge au grain à grain. Le tri a permis de diminuer la concentration en mycotoxine DON et OTA de certaines fractions. Le trieur visible-infrarouge a été le plus efficace.
La spectrométrie proche infrarouge (SPIR) est une méthode indirecte efficiente pour prédire sur base de calibration les teneurs en constituants chimiques comme la teneur en protéines. Nous avons construit des calibrations SPIR sur base d’une grande diversité d’échantillons. Les données spectrales et les valeurs de référence ont été implémentées dans l’outil CRAWLSPEC qui a été développé par le CRA-W pour permettre la centralisation et l’intégration des données ainsi que l’extraction et l’exploitation des données. Des calibrations SPIR ont été construites pour les paramètres rhéologiques du froment et de l’épeautre sur base des spectres de leur grains, mouture intégrale ou farine blanche. Les 3 modes de présentations donnent les mêmes niveaux de performances de prédiction. Les performances de prédiction pour les paramètres de qualité de gluten (Zélény, force du gluten…) sont trop médiocres pour être utilisées de manière contractuelle. Ces prédictions peuvent être très utiles pour de l’allotement de lots et de la sélection variétale quand la variété est inconnue. Les performances de prédiction pour les paramètres de qualité de l’amidon (Rapid Visco Analyzer) sont inexploitables. Les faibles niveaux de performance de prédiction pour les paramètres rhéologiques s’expliquent par le fait que, dans le grain et la farine, le gluten n’est pas encore formé et l’amidon n’est pas sous forme empesée. La SPIR a démontré sur plusieurs spectromètres (XDS FOSS, Infratec NOVA FOSS, QSorter Qualysense, FX17 SPECIM) son potentiel pour évaluer le taux de mitadinage du blé dur de manière plus objective et moins laborieuse que la méthode de référence.
L’imagerie hyperspectrale proche infrarouge constitue une méthode efficiente pour détecter les impuretés et contaminants dans les grains ou farines sur base de la signature spectrale. Elle peut servir d’étape de présélection pour orienter le nettoyage ou les analyses permettant de consolider la confiance dans les circuits courts. Nous l’avons développé pour détecter de manière ciblée et performante 8 catégories d’impuretés et contaminants présents dans grains de céréales : sol et graviers, déchets plastiques, insectes, résidus de récoltes et boutons floraux, grains cariés entiers, sclérotes d’ergot, graines de datura, graines étrangères d’adventices. Cette application est en mesure d’évaluer la pureté générale d’un lot de céréale. Ce type d’imagerie a également été appliquée pour mesurer la composition et suivre l’homogénéité des formulations de semoules et de farines au sein de la filière céréalière. Les résultats obtenus sur le couple froment-blé dur montrent que l’intégration en routine est possible. Pour le froment-épeautre, les résultats sont à améliorer pour être applicable.
Plateforme de mouture sur cylindre et sur meule
Les propriétés technologiques des farines dépendent du type de mouture et du type de moulin. Il est nécessaire de disposer de différents types de moulins pilotes pour répondre aux besoins expérimentaux des acteurs céréaliers wallons. La plateforme de mouture sur cylindre et meule a donc été conçue pour produire des lots de farine ou de semoule de plusieurs kg adaptés aux essais pilotes de transformation ainsi que l’évaluation technologique d’essais de variétés et de fumures. Cette plateforme est notamment constituée de :
- Moulin à 6 cylindres (Buhler MLU-202) - 3 passages sur cylindres cannelés et 3 sur cylindres lisses pour la production de lots pilotes et brosse à son pour l’estimation du rendement en farine
- Moulin à meule en granit pour la production de lots pilotes
Le moulin Buhler MLU-202 permet d’obtenir une farine blanche avec des propriétés technologiques semblables à celles des meuneries belges. Elle a donc été utilisée pour produire de la farine blanche en quantité pour les essais de panification (norme NBN VF12-001). Des variétés plus adaptées à la mouture sur meule ont été identifiées.
Plateformes d’analyse de semoule de blé dur et de malt d’orge brassicole
Pour le développement de filières de céréales pastières ou brassicoles, il est incontournable de disposer d’un laboratoire d’accompagnement neutre pour évaluer la qualité technologique de sa matière première et recommander des variétés adaptées à notre pédoclimat, nos modes de production et nos transformateurs. Il est également essentiel de prévenir les pertes économiques liées aux déclassements inutiles de lots acceptables.
Pour le blé dur, une méthodologie intégrant la production de semoule a été mise en place afin d’être en mesure d’évaluer plus finement l’aptitude à la transformation du blé dur. Elle a pu être établie grâce à notre moulin CD2 et son sasseur, équipements indispensables pour déterminer la qualité technologique du blé dur mais ils sont pourtant rares, notamment en Europe. C’est une opportunité inédite pour la Wallonie. Elle a été appliquée dans le cadre du Projet Relocalisation alimentaire N°89 Blé dur et ses essais variétaux. Elle a permis d’identifier des variétés permettant d’obtenir du blé dur de qualité élevée en Wallonie au nord du sillon Sambre-Meuse.
Pour l’orge brassicole, les méthodes d’analyse standard ont été mises en place sur le malt issu des micro-maltages des essais variétaux wallons. Cette évaluation technologique est basée sur le brassin conventionnel et la friabilité du malt.
Communications
Le projet ValCerWal a communiqué de manière proactive sur ses recherches à de nombreuses reprises. Il a produit plus de 78 communications sur 4 ans à destination de différents types de publiques (scientifique, technique, grand public) tant sous forme écrite dans des journaux, des livres et une thèse qu’orale par des présentations à des rencontres, visites, démonstrations et formations destinées à la filière. Une grande partie des communications ont été réalisée à destination des acteurs de la filière céréalière wallonne. Elles ont été effectuées en association avec les partenaires du projet, à savoir le Centre Pilote wallon des Céréales et des Oléo-Protéagineux (CePiCop), le Collège des Producteurs, ainsi qu’avec Biowallonie. Le projet ValCerWal a également diffusé les résultats de ses recherches à l’occasion de son Symposium ValCerWal.
Des bonnes pratiques pour assurer la qualité technologique et sanitaire des lots panifiables en termes de choix variétal, fumure azotée, phytotechnie, pré-récolte, récolte, allotement, échantillonnage, analyses avant transformation, stockage et tri ont été établies dans le cadre du projet ValCerWal. Ces bonnes pratiques ont notamment fait l’objet de nombreuses reprises par des :
- Articles écrits techniques destinés à la filière céréalière wallonne comme le Livre blanc Céréales, Itinéraire BIO, BioCérès, Avertissements CePiCOP et Vademecum Création d’une filière céréalière (en association avec le Projet FarWal)
- Présentations aux évènements techniques céréaliers wallons comme le Livre blanc Céréales, Journées filières panifiables wallonnes, Journée Interprofessionnel BIO, Visites des champs d’essai, FEGRA et Séances d’information de filières spécifiques
Ces bonnes pratiques ont notamment été diffusées auprès d’agriculteurs, stockeurs et transformateurs (environs 30 chaque année) qui ont été accompagnés par l’analyse technologique et l’évaluation de l’aptitude à la transformation de lots de matière première.
Le Collège des Producteurs a mis à jour et diffusé le Plan de développement stratégique 2030 en céréales alimentaires pour la Wallonie en association avec le projet ValCerWal.
Conclusion et perspectives
La production de céréales pour l’alimentation humaine est possible en Wallonie. La relocalisation de cette production est nécessaire pour nous rendre plus résilient face aux crises mondiales successives et pour se substituer graduellement à la production de bioéthanol de première génération. Cette relocalisation permettra de garantir un approvisionnement local et plus durable pour nos transformateurs ainsi que plus de valeur ajoutée pour nos agriculteurs. Les céréales alimentaires doivent en fonction de leur utilisation répondre à des critères spécifiques en termes technologiques (qualité des protéines et de l’amidon) et sanitaires (teneur en mycotoxines et impuretés). Ces freins liés à la qualité sont critiques car ils impactent la possibilité de commercialiser les céréales sur des marchés exigeants réduisant les marges des producteurs et limitant leur compétitivité. Le projet ValCerWal a pu mettre en évidence le potentiel des outils post-récoltes comme le tri des grains et les méthodes alternatives (chromatographie, rhéologie rapide, spectrométrie et imagerie proche infrarouge) d’évaluation de la qualité pour permettre la constitution de lot homogène et de qualité ainsi que la nécessité de variétés et fumures azotés adaptées aux objectifs de qualité. Des informations au sujet desquels le projet ValCerWal a largement communiqué. Pour mettre en œuvre ces solutions de manière viable, il paraît crucial de construire des filières plus intégrées avec une vision à moyen et long terme garantissant un partage équilibré des risques et bénéfices entre les différents maillons de la filière. C’est essentiel pour une transition vers une Wallonie plus durable et résiliente.
La technologie de tri optique infrarouge au grain à grain permet un tri très spécifique. La perte de grains de bonne qualité au tri est nettement moindre par rapport aux trieurs physiques. Il permet la production de froments améliorants ou sur mesure localement et en limitant le déclassement des lots. Cette technologie est d’autant plus critique en agriculture à faible intrant et biologique où la fréquence de déclassement de lots est plus importante en raison des conditions environnementales moins favorables. Elle pourrait aussi apporter une nouvelle plus-value pour la caractérisation approfondie des lots en temps réel à haut débit pour en évaluer la qualité. En plus, de donner une valeur moyenne pour les paramètres mesurés, elle donne toute la distribution. Cela permet de décider de l’intérêt de trier un lot et de la stratégie de tri à mettre en place pour atteindre la qualité visée. Ce type de tri est également un outil de phénotypage permettant de développer des nouvelles variétés de manière efficiente.
D’autres leviers pré- et post-récoltes que le tri devraient également être explorés pour diversifier les outils disponibles et garantir la qualité des céréales alimentaires. Des traitements physico-chimiques en post-récolte du grain ainsi que le suivi de la qualité du grain juste avant et après la récolte à la ferme pourraient être envisagés.
Pour faire correspondre les variétés aux besoins des transformateurs, une évaluation technologique annuelle approfondie des variétés de froment panifiable, épeautre, orge brassicole et blé dur cultivées en Wallonie spécifique à l’agriculture conventionnelle et biologique doit être maintenue de manière pérenne car la durée de vie commerciale des variétés est courte et la disponibilité en semences est faible et variable en Belgique.
Pour évaluer l’aptitude à la panification, il serait essentiel de la compléter par des essais de panification pour des pains de type belge (norme NBN VF12-001). Ce type d’essais permettrait d’étudier les gains nutritifs apportés par les farines plus intégrales, l’ajout de protéagineuses, les moutures sur meule et les fermentations au levain.
Le développement de filières de blé biscuitier et brassicole adaptées à notre pédoclimat et nos transformateurs permettrait d’accroitre la production de céréales alimentaires en Wallonie tout en prenant moins de risque de déclassement. Il serait nécessaire d’identifier des variétés adaptées à notre pédoclimat.
La méthode validée pour l’analyse multi-mycotoxines des Fusarium par chromatographie en froment a permis de confirmer la présence des mycotoxines de ce pathogène en Wallonie dont les mycotoxines émergentes ENN. Elles ne sont pas réglementées et leur toxicité est à l’étude. La présence accrue en Wallonie de l’ergot pour le froment nécessiterait aussi un screening pour ses alcaloïdes à l’échelle de notre territoire pour s’assurer le respect des nouveaux seuils réglementaires. L’étude du tri pour la gestion des contaminants devrait être élargie à des concentrations initiales plus élevées en mycotoxines et en étudier d’autres comme celles qui sont émergentes.
Les méthodes alternatives de mesure de la qualité sont essentielles pour rendre son évaluation efficiente. La chromatographie d’exclusion de taille ou de phase inverse ont permis d’obtenir des profils protéiques précis et reproductibles en froment. Une modélisation plus avancée serait nécessaire pour les relier à la qualité technologique.
La spectrométrie proche infrarouge est performante pour prédire la teneur en constituants chimiques et le taux de mitadinage. Elle est trop médiocre pour la prédiction de la qualité de gluten (Zélény, force du gluten, …). Elle est exploitable pour orienter l’allotement de lots et de la sélection variétale quand la variété est inconnue.
L’intégration de l’imagerie hyperspectrale proche infrarouge en routine en milieu industriel permettrait des mesures en continu, non destructives et sans préparation d’échantillon, autorisant un suivi intense des lots et une réduction de lots non-conformes en termes d’impuretés et de contaminants.
Le projet ValCerWal est mené en partenariat avec le CePiCOP et le Collège des Producteurs.
Financement
Ce projet est financé par le plan de relance de la Wallonie. #WallonieRelance
Retour dans la presse
15 juin 2023 - Canal zoom - Le JT - ValCerWal : des céréales 100% wallonnes